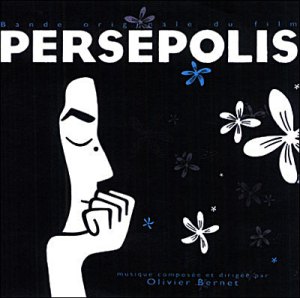L’arrogance flegmatique, le ricanement désenchanté, la mise à distance du rap : tout Doc Gynéco est contenu dans son premier album. A commencer par ses errements ultérieurs. « Première consultation » est si novateur que la suite de sa carrière paraît superflue. Le disque fait figure d’apparition fugitive de Doc Gynéco dans l’espace musical, le traversant comme un météore et se consumant au contact de l’atmosphère. « Quality Street », la queue de la comète, a définitivement signé le crépuscule de l’idole déchue.
Depuis une décennie, Doc Gynéco s’attache à détruire sa propre légende avec une constance qui forcerait presque l’admiration. Si bien que ses flirts germanopratins et ses amitiés présidentielles ont fait oublier son génie originel. Dans l’imagerie médiatique, Doc Gynéco est devenu ce rebut calciné par le cannabis qui promène gauchement sa carcasse bouffie de plateau en plateau, le plus souvent sous les lazzi d’un public amnésique, en traînant dans son sillage des volutes de fumée clandestine. Au mieux, il est perçu comme une déclinaison vaguement hip-hop de Michel Sardou. Enfermé dans sa propre caricature, Doc Gynéco soliloque en silence. On a désormais peine à imaginer qu’il y a dix ans, Bruno était le roi du pétrole. La vache à lait de Virgin et du Secteur Ä. Deuxième moitié des années 1990 : c’est l’époque bénie où les albums de rap se vendent par centaines de milliers d’exemplaires. Du haut de son million de disques écoulés, Doc Gynéco peut se permettre toute sa morgue cool et désabusée. Tout paraît facile. Le succès est d’autant plus foudroyant que Bruno Beausir, 22 ans à peine, débarque de nulle part. Jusque là, il n’a fait entendre son flow chaloupé que le temps d’un couplet incongru sur « 95200 », le deuxième album du Ministère AMER. Doc Gyneco y laisse déjà percevoir un personnage atypique, désinvolte et railleur. Première consultation lui offre l’espace nécessaire pour exprimer pleinement son indolente insolence.
Par le truchement de son premier disque, Doc Gynéco a d’abord imposé une attitude. Ses allures de lendemain d’orgie ambulant et sa nonchalance goguenarde tranchent avec les codes en vigueur du rap. En dépit d’un vague parfum de provocation gainsbarienne, Doc Gynéco séduit le grand public grâce à sa dégaine inoffensive d’adolescent dégingandé et lunaire. Posters aux murs et skateboard au pied du lit sur la pochette, Bruno Gynéco correspond au portrait-robot du jeune moyen. Pas franchement de quoi inquiéter. Quelques mois plus tôt, Passi et Stomy Bugsy, ses collègues du ministère AMER, en appelaient au ‘Sacrifice de poulets’. Lui passe pour le rappeur sympa. A rebours de ses coreligionnaires de la Secte Abdoulaï, Gynéco le dandy déleste son propos de tout discours militant. Bruno Beausir n’est pas un contempteur : c’est un contemplateur. Ses principaux sujets de préoccupation : les filles, le foot, les filles, son quartier, les filles, le sexe et les filles. Et puis aussi, de temps en temps, les filles. Le rappeur croque le quotidien de Bruno en quelques chroniques pittoresques, en évitant soigneusement la street surenchère. Et le résultat coule comme du miel chaud. Doc Gynéco pose un regard moqueur et attendri sur son environnement dont il extrait avec humour la tragique banalité. De ‘Passement de jambes’, exercice de name-dropping footballistique, aux ‘Filles du moove’, évocation tendre d’une génération de starlettes anonymes, le rappeur badine allègrement avec son quotidien.

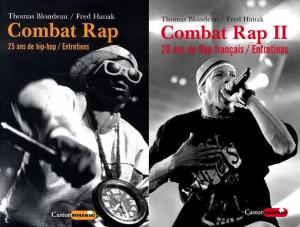







 Lien vers le clip
Lien vers le clip